
Voici à quoi peut correspondre la découverte d'un insecte piégé
sans sa résine fossile lorsqu'on le regarde pour la première fois
avec une loupe au grossissement x10... Bien évidemment, après
l'examen visuel, il faut réaliser la macrophotographie et
expliquer, lorsque cela reste possible, l'histoire antique
qui a finalement amené l'insecte
vivant au piège végétal...
Et, d'ailleurs, pourquoi la fourmi est-elle blanche ?
Fourmi "blanche" est-ce le nom d'un termite ?
Non, ici c'est bien une fourmi.
Quel est donc ce mystère
du linceul blanc
de la fourmi ?
Grâce
à l'ambre lumière sur
l'origine paléontologique
des Fourmis (*)
|
Les
11 000 espèces actuelles de fourmis constituent assurément
le groupe animal le plus vaste représenté sur terre en
nombre d'individus. Si le nombre d'espèce est somme toute assez
raisonnable (environ 2% de l'entomofaune), la biomasse des fourmis est
vraiment hallucinante ! On estime que le poids cumulé de
toutes les fourmis vivantes actuelles représente le poids de
l'humanité, (c'est-à-dire le poids de tous les hommes
ayant vécut sur terre). Devant pareille présence ubiquiste,
presque effrayante on se demande si les fourmis auraient subsisté
si elles étaient uniquement prédatrices comme à
leur origine. Evidemment l'évolution a modifié les choses,
(heureusement pour l'homme) et, cette notion d'évolution nous
ramène à l'origine des fourmis, et, nécessairement
à la pierre d'ambre... Où quand et comment est né
le groupe des fourmis ?
|

Pour ceux qui étudient les insectes, la prépondérance des fourmis actuelles ne fait aucun doute, mais, au cours
des époques géologiques, évidemment, il n'en a pas toujours été ainsi. Et, à l'exemple de cette fourmi de l'ambre
(Ambre d'Houdancourt, Sparnacien, l'Éocène inférieur, 54 - 56 M.A.) aux longues mandibules (spécimen
jamais référencé !) certains groupes dénichés dans la pierre de résine permettent d'appréhender la
réussite écologique du groupe animal le plus vaste représenté sur Terre.
Pour obtenir des documents originaux contactez l'auteur
à l'adresse: eric.ambre.jaune@hotmail.fr
|
Les
récents travaux de 2005 sur l'analyse génomique des fourmis
contemporaines ont permis de dégager une phylogénie intéressante
qui s'accorde enfin avec les morphologies des fossiles. La collecte
récente de quelques fossiles d'ambre du Crétacé
(141 - 65 M.A.) et surtout le bestiaire conséquent et très
riche du Paléogène (65 - 23 M.A. correspondant au tertiaire
inférieur : Oligocène, Eocène, Paléocène)
a permis de compléter l'arbre phylogénique par une datation
indépendante des évènements.
|
|
La
vie progresse à partir d'un précédent (également
vivant) sur lequel s'opère une sélection des potentialités
chimiques (ADN et gènes), potentialités chimiques qui
orientent d'éventuelles transformations morphologiques, dans
ce groupe qui peut comporter des castes. Le déroulement historique
et phénotypique des fourmis n'est alors pas simple. Ainsi, des
fourmis parmi les plus archaïques "morphologiquement"
ne sont pas forcément les plus anciennes géologiquement
et inversement ! Au grand dam des scientifiques qui voyaient une
évolution aux morphologies graduelles, certains ont poussé
la théorie jusqu'à inventer des indices numérique
pour qualifier le degré d'évolution d'un spécimen.
Ignorant, sans doute les faits du vivant et l'appréciation de
l'anatomie particulière des fourmis, Dlussky a imaginé
des ratios numériques pour rapprocher les morphologies des fossiles.
Le "savant" inventeur a proposé la mesure
des organes ancestraux pour donner une valeur d'index aux spécimens.
Il a recommandé de mesurer la forme des pétioles des fourmis
(index IK1) pour caractériser la proximité des spécimens.
Dlussky a alors proposé Haidomyrmex Dlussky 1996, comme
une sous famille possible des Sphecomyrminae. Bon, ok pour le nom, mais
rien d'étonnant à ce que les valeurs d'index réalisées
sur ces fourmis birmanes soient critiquées par d'autres chercheurs
: Grimaldi et al., 1997.
Le simple n'est pas forcément ancestral, le simple peut être, à l'inverse, l'essentiel que l'évolution conserve par le jeu de la sélection naturelle. Le très simple serait alors le degré ultime de qui est très évolué ? Ne simplifions pas trop, trop vite. Chez les fourmis toutes les séries semblent pouvoir progresser selon des modèles spécifiques ; les séries peuvent progresser par radiations, par paliers, par progressions parallèles et/ou par rapprochements. Cependant, la phylogénie des fourmis est, en grande majorité sur le type d'un cône global à diversification croissante. Et, tout semble enfin rentrer dans l'ordre dans des évènements que l'on peut enfin dater. |
|
Les
évènements de l'arbre évolutif des fourmis comportent
une radiation initiale au milieu du Crétacé (- 100 millions
d'années) contemporaine de la prolifération des Angiospermes.
La plus vieille fourmi connue a ce jour été trouvée
dans de l'ambre français d'Archingeay-les-Nouillers (Charente-Maritime).
Si la découverte de Gerontoformica cretacica est somme toute
assez logique (et prévisible Eric G. 1998, 2000 et 2002) compte
tenu du potentiel énorme des si nombreux gisements français
du Crétacé, ce qui est plus surprenant, ce sont l'extraordinaire
diversité et la spécialisation des fourmis à cette
époque si ancienne ! On peut supposer que ces Gerontoformica
françaises, munies de longues pattes et outillées de mandibules
si allongées, puissent avoir mené une vie de prédation.
Le déficit de fossiles du Crétacé inférieur
dans les gîtes d'Angleterre, de Sibérie et d'Espagne, ne
permet cependant pas pour l'instant d'affirmer le lieu de l'apparition
de ces fourmis. A ce jour, la rareté des découvertes des
fourmis de cette époque ne permet pas de certifier l'asile et
l'origine précise où auraient eu lieu les premières
radiations de ces insectes, même si l'on évoque souvent
la Laurasie. Sans doute, la lignée des fourmis n'est-elle pas
apparue sur le continent antique du Gondwana, et, la prochaine découverte
fondamentale serait alors d'identifier finalement une fourmi dans l'ambre
du Liban (daté de 130 M.A.) ce qui ne semble pouvoir jamais être
le cas.
|
|
Le
Paléogène, (époque géologique située
entre 65 - 23 M.A.) a vu se développer la dominance écologique
des fourmis parallèlement à celle des angiospermes des
forêts tropicales. Les fossiles de l'ambre montrent enfin une
fréquence de piégeage plus importante des fourmis. L'examen
des syninclusions fossiles et les descriptions morphologiques prouvent
qu'il y a eu des changements dans le régime alimentaire de ces
insectes (ubiquistes ?) leur permettant d'étendre encore leurs
domaines à d'autres niches écologique et mêmes aux
biotopes les plus étranges notamment ceux des environnements
les plus secs.
|
|
A
ce jour, deux groupes initiaux ont été identifiés
avec les Sphecomyrminées (représenté par
des spécimens fossiles des gisements du New jersey) et les ancêtres
des Formicinées actuelles (avec évidemment le registre
plus anciens des fossiles français).
|
|
Découverte
en 1966 dans l'ambre du New Jersey, 92 M.A., Sphecomyrma freyi
(la première fourmi proposée comme sérieux progénote,
l'ancêtre du groupe) montrait une morphologie intermédiaire
qui reliait incontestablement les fourmis aux guêpes. On en a
conclu que le spécimen était la fourmi ancestrale... Position
sûre, et ce, d'autant que le fossile était le seul à
provenir d'un ambre ancien, les autres n'étant âgées
que de 50 M.A. grand maximum. La morphologie archaïque de la fourmi
en faisait la représentante unique des fourmis primitives, mais,
les découvertes récentes de fourmis françaises
très anciennes (aux morphologies portant moderne) infirme cette
théorie du progénote américain. Les Sphecomyrma
américaines qui combinaient des caractères de fourmis
et de guêpes ont effectivement été trouvées
dans toute la Laurasie. Certes. Mais, rares à cette époque
(en nombre d'individus dans les biotopes) elles apparaissaient en inclusions
de l'ambre, et, problème: sans qu'on connaisse la raison, elles
ont disparu du registre des espèces il y a environ 10 - 20 millions
d'années.
Assez tôt au cours de leur histoire, les Sphecomyrma ont subi une radiation biotique et morphologique qui a offert divers embranchements dont des intermédiaires sphecomyrmines-ponerines. Précision d'un confrère espagnol: "Les myrmeciinées (à ne pas confondre avec les Myrmicines actuelles) qui en dérivent, constituent les survivants originels de la première radiation, (citons par exemple Nothomyrmecia macrops, la fourmi bulldog actuelle australienne et Myrmecia une fourmi inhabituel de Nouvelle Calédonie)". |
|
Dans
les années 1900 - 1910, le chercheur, William Morton Wheeler,
était le premier spécialiste incontesté des insectes
sociaux. Et, la plupart des fourmis de l'ambre connues à l'époque
furent étudiés, soit 10.000 spécimens environs.
Toutes les fourmis provenaient en grande partie de l'Institut Géologique
de Königsberg et de la collection privée du professeur Richard
Klebs. Le matériel était originaire de l'est de la Baltique,
soit 45 millions d'années, et cataloguait parfaitement l'expansion
et la diversification rapide des insectes... Le registre des 10.000
fourmis prouve aujourd'hui évidemment encore la diversification
rapide des fourmis au milieu de l'Eocène, (une rapidité
en nombre d'individus qui se répandent dans tous les biotopes,
et, également une rapidité du développement du
nombre des espèces). Ainsi, les Myrmicines, Formicines et Dolichodérines,
prolifèrent en compagnie des ponerines. On découvre dans
les fossiles de l'ambre effectivement des ponerines et des myrmicines
"primitives". On s'accorde pour dire que les fourmis ponérines
actuelles ont conservé leurs caractères primitifs, de
même, on bâtit le complexe des formicoïdes qui rayonne
rapidement (répartition ubiquiste dans le monde entier), avec
de vraies fourmis formicines ou des "hybrides", mélanges
d'aneuretines et de dolichoderines. Aneuretus simoni vit
par exemple au Sri-Lanka.
|
|
Dès
le milieu de l'Eocène, les trois sous-familles de la faune actuelle,
Myrmicinées, Dolichodérinées et Formicinées
sont établies. Et, il faut aussi noter que l'écrin de
miel montre que des Ponérines ont conservé dans le temps
nombre de caractères morphologiques primitifs et également
comportementaux comme la chasse individuelle des arthropodes ce qui
suggère une indépendance sans doute relative de l'odeur
communautaire de la colonie et des congénères rencontrés
par hasard pendant les chasses. Avec le poids des anciennes théories
et des indices inventés, on s'étonne que les "caractères"
primitifs puissent permettre un succès évolutif étonnant.
La tradition des vielles idées est tenace, et, plusieurs myrmécologues
suggèrent (pour ne pas dire certifient) une adaptation à
de nombreuses niches écologiques relativement étroites;
c'est à dire une notion de "restriction" en quelque
sorte...
|
|
Non,
soyons plus ouvert et clairvoyant.
Je (=Eric G.) pense strictement l'inverse. Il n'y a pas restriction. Non, le potentiel : "ouvert à TOUT" est là dès l'origine, pour TOUT le MONDE. Les fourmis peuvent TOUTES s'installer PARTOUT. Et, si certaines choisissent une niche écologique particulière, qui semble restrictive, la vie souterraine, par exemple, c'est sans doute le fait d'une potentialité génétique (en développement), qui peut d'ailleurs -sans doute déjà à cette époque éloignée- permuter à souhait si le besoin s'en fait sentir. C'est ainsi peut-être que les premières associations entre espèces différentes s'inventent, (ce sont des fourmis qui ne se font pas la guerre mais s'entraident). Il faut évidement discuter des syninclusions (fourmis synchrones dans les mêmes fossiles d'ambre) et des niches écologiques des espèces en prenant garde de ne pas oublier que la fenêtre d'observation par l'ambre raccourcit considérablement les notions d'évolution spatiales ! Evolutions sur le plan de la latitude, sur le plan du climat, et, également sur la nature des forêts selon les arbres présents qui constituent les canopées tropicales. Il faut aussi et SURTOUT garder à l'esprit que l'étude de l'évolution des morphologies anatomiques des fourmis fossiles de l'ambre semble assez indépendante (ou difficilement corrélable) à l'émergence des comportements sociaux. Certaines fourmis actuelles, comme les Nothomyrmecia aux comportements sociaux "fossiles", bien que très mobilisatrices pour quelques hypothèses théoriques intéressantes, n'offrent pas le type tangible à partir duquel les fourmis auraient progressé -par expressions morphologiques et comportementales- L'annotation d'une particularité anatomique sur une morphologie fossile ne constitue pas la preuve irréfutable d'un comportement antique (dont la référence d'étude est celle des espèces actuelles, éloignées de plusieurs dizaines de millions d'années, Eric G 1998). Les morphologies ne peuvent pas, aussi simplement, être "corrélées" aux comportements, et inversement ! Petite digression: prenons, par exemple, les cas des Linsangs actuels d'Afrique et d'Asie, le premier animal est apparenté aux genettes et le second est apparenté aux félins ! Ces animaux ont pourtant des morphologies si proches qu'ils ont toujours été classés dans le même groupe. Les deux types, (aux comportements différents), ont convergé vers une même apparence créant même un paradoxe étrange et inexplicable ! (La morphologie n'est alors pas corrélée aux comportements). |
|
Un
coup de pied dans la fourmilière ambrée pour réviser
la phylogénie des fourmis !
Résultat de la découverte remarquable d'un géologue éthiopien, un bestiaire crétacé conservé dans l'ambre jaune vient bouleverser la phylogénie des fourmis. Là où certains paléo myrmécologues voyaient (et espéraient) des évolutions transitoires et graduelles des fourmis, une découverte vient invalider cette conception. Tandis que l'ambre insectifère crétacé est assez commun dans l'hémisphère nord, les dépôts d'ambres crétacés sont rares sur l'ancien supercontinent du Sud, le Gondwana. L'ambre jaune éthiopien révèle des fourmis ancestrales dont les morphologies sont identiques à Martialis heureka, relativisant alors totalement les "archéo types" imaginés des progénotes. Les fourmis les plus anciennes ne sont définitivement pas les plus archaïques morphologiquement comme le dogme l'imposait. La fourmi gondwanienne d'Éthiopie aux allures sveltes évoluées est cependant plus jeune de 5 - 10 M.A. que celle française des Charente-Maritime... |
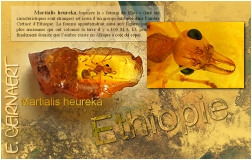
Martialis
heureka, retrouvée dans
l'ambre Crétacé d'Ethiopie.
|
C'est
un constat fait à partir des entomofaunes de l'ambre, les fourmis
-issues du groupe des guêpes- sont donc apparues au cours du Crétacé,
il y a 100 millions d'années. A ce jour, la référence
fossile la plus ancienne est encore Gerontoformica cretacica
dans l'ambre de l'Albien supérieur (-112 millions d'années
à -99 millions d'années) originaire de Charente-Maritime.
A coté de cette référence française, la
découverte de Martialis heureka (de la sous-famille des
Martialinae) dans l'ambre crétacé d'Ethiopie vient
troubler l'idée assez consensuelle que l'on avait de la phylogénie
des fourmis. Il est déconcertant de découvrir, si tôt
dans l'origine du groupe, des phénotypes très spécialisés
de fourmis souterraines dont on remarquera que les représentants
actuels sont dépigmentés et aveugles.
Les guêpes ont trouvé le potentiel de devenir fourmis en recherchant la solution souterraine. Si des lignées sont restées aveugles, d'autres ont recouvré la vue pour développer une multitude de configurations particulièrement bien adaptées aux différents biotopes rencontrés. Pour terminer, on notera que la phylogénie des fourmi est surtout incertaine tant les sites crétacé sont peu étudiés ou pas encore connus. On rappellera que les études des fourmis de l'ambre se limitent trop souvent aux spécimens montés en lames minces, (ambres découpés qui perdent alors une foule considérable de renseignements précieux que l'opérateur a sacrifié ou négligé). Ne maîtrisant pas complètement la technique de macrophotographie traditionnelle des inclusions dans les ambres opaques (alors que les solutions simples existes) les chercheur s'orientent vers les techniques de pointe des imageries scanner en 3D. Ne perdons pas les objectifs finaux. La fourmi et l'ambre sont inséparables, et peuvent encore révéler de belles surprises sans obligatoirement utiliser du matériel coûteux. L'histoire est trop belle pour se terminer là, et, je poursuivrais la phylogénie des fourmis au prochain épisode (avec une nouvelle inclusion), avec sans doute de beaux fossiles de l'ambre. Dossier non finalisé, affaire à suivre... |
Complément de lecture et question ici
(*) Pour éviter le piratage et que ce texte soit aspiré dans des sites peu scrupuleux, (et ils existent) plusieurs erreurs
volontaires (importantes) on été intentionnellement dissimulées dans la rédaction. Le repérage de ces
erreurs permettra alors de suivre les pirates... Les personnes qui souhaiteraient la rédaction
(vierge d'erreur) pourront l'obtenir à l'adresse: eric.ambre.jaune@hotmail.fr
Les ambres crétacés

Concernant l'ambre, vous avez une question, une remarque ?
Participez alors au Forum de l'ambre